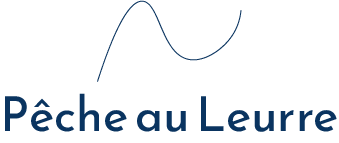Tortues marines, dugongs et récifs coralliens comptent parmi les espèces sensibles dont la préservation favorise un meilleur équilibre océanique. Malgré les aires marines protégées comme le Sanctuaire Pelagos, la surpêche et les différents types de pollution affectent leur survie. Des approches comme la gestion réfléchie des ressources, l’attention à la saisonnalité, l’ajustement des quotas, l’emploi de filets adaptés et l’implication collective, en incluant les pêcheurs, peuvent participer à leur protection.
Sommaire
Les gardiens des océans
La diversité biologique marine constitue la base de nombreuses interactions vitales dans les océans. Cependant, elle fait face à des pressions diverses telles que les prélèvements excessifs, la pollution, la dégradation des habitats côtiers et les effets du changement climatique. Parmi les espèces à préserver figurent les tortues marines et les dugongs, parfois qualifiés d’« espèces parapluies » en raison de leur influence sur d’autres éléments du milieu marin.
Les tortues vertes interviennent dans la gestion naturelle des herbiers marins. En se nourrissant de ces végétaux, elles favorisent leur régénération et réduisent les risques d’envasement, ce qui bénéficie à de nombreuses autres espèces. En leur absence, une prolifération végétale désorganisée pourrait perturber ces milieux essentiels pour divers poissons et invertébrés y trouvant refuge ou nourriture.
Les dugongs, parfois appelés « vaches de mer », contribuent également à limiter le développement excessif des algues. Leur présence dans certains espaces permet de maintenir la qualité des herbiers marins, qui abritent des stades précoces de nombreuses espèces marines. Préserver ces mammifères revient donc à soutenir une partie de la structure naturelle des écosystèmes.
Ces organismes servent également de signaux sur l’état général des milieux marins. Leur diminution est souvent le signe d’un environnement qui se détériore, avec des conséquences potentielles pour d’autres espèces, y compris celles capturées à des fins commerciales. Il devient pertinent de mettre en place des mesures de gestion ciblée, incluant des zones protégées et des efforts en restauration écologique.
Mais l’attention ne doit pas se limiter à ces quelques espèces connues. Les récifs coralliens, bien qu’ils représentent moins de 1 % de la surface océanique, servent d’habitat à environ un quart des espèces marines connues. D’après la Banque mondiale, plus de 30 % de ces structures coralliennes, ainsi qu’un nombre important de mammifères marins, subissent des pressions diverses ayant un impact sur leur pérennité. Cette perte pourrait provoque des déséquilibres en cascade sur l’ensemble du vivant marin, mais aussi sur les économies côtières dépendantes de ses ressources.
Pour explorer plus en détail les enjeux liés à ces espèces marines à préserver, vous pouvez consulter cette vidéo explicative :
Tableau des espèces menacées
| Espèce | Statut UICN | Menace principale |
|---|---|---|
| Tortue verte | En danger | Captures accidentelles, pollution, destruction des nids |
| Dugong | Vulnérable | Dégradation de l’habitat, collisions avec bateaux |
| Anguille d’Europe | En danger critique | Surpêche, obstacles fluviaux, déchets chimiques |
| Strombe rose | Vulnérable | Collectes successives |
| Hippocampe | Vulnérable | Prélevé pour aquarium et usages médicinaux |
| Corail méditerranéen | En danger | Chauffe des eaux, acidité croissante, chalutage |
Ce tableau illustre quelques espèces dans des états préoccupants. D’autres, comme les étoiles de mer, ophiures, oursins et syngnathes, bénéficient selon les zones de mesures de protection. Leur intégration dans des plans de conservation reste utile, car elles participent à la stabilité des milieux marins.
« En 2022, on a observé trois cachalots dans le Sanctuaire Pelagos. Cela suggère que certaines mesures de protection facilitent le retour de certaines espèces marines. », partage Marc, garde-moniteur du parc marin.
Solutions pour une pêche durable
Aires marines protégées et CITES
Définir des aires marines protégées (AMP) figure parmi les démarches possibles pour favoriser la survie des êtres vivants marins. Le Sanctuaire Pelagos, s’étendant sur plus de 87 000 kilomètres carrés entre la France, Monaco et l’Italie, abrite plus de 8 500 espèces recensées, y compris des espèces fragilisées. Leur existence encourage un retour progressif de certaines espèces et soutient les zones périphériques en permettant leur renouvellement biologique.
D’autre part, la Convention sur le commerce des espèces menacées (CITES) établit un cadre pour limiter certaines transactions internationales. Elle protège entre autres les hippocampes et divers mollusques. Malgré cette réglementation, son application reste variable selon les territoires, ce qui invite à renforcer les mécanismes de contrôle – par exemple via des systèmes satellitaires ou une meilleure traçabilité des produits issus du milieu marin.
La gestion d’une AMP demeure d’autant plus constructive lorsqu’elle implique différents acteurs locaux tels que les chercheur·euse·s, les collectivités publiques et les communautés de pêcheurs. Divers exemples, en Méditerranée ou dans l’Atlantique Nord-Est, montrent que la concertation permet des progrès mesurables dans le temps.
Pêche durable et alternatives économiques
Face aux impacts des pratiques courantes, la recherche de méthodes plus respectueuses du vivant s’avère pertinente :
- Utiliser des filets ciblant certaines espèces tout en laissant passer les autres, pour diminuer les captures non intentionnelles.
- Déterminer des quotas prenant en compte l’état actuel des stocks halieutiques ainsi que les périodes de reproduction.
- Encourager le recours à l’élevage responsable de certaines espèces pour diversifier les ressources disponibles.
- Mettre en avant les produits issus de démarches respectueuses de l’environnement, comme ceux labellisés MSC.
- Soutenir la consommation locale et privilégier les poissons moins sollicités capturés selon des méthodes douces.
Ces propositions nécessitent un accompagnement social et économique pour les populations dépendantes de la pêche. Certaines régions testent des modèles de co-gestion intégrant les professionnel·le·s, ce qui favorise une organisation plus fluide des zones de pêche. Cette approche semble parfois améliorer les rendements sur la durée, tout en maintenant des conditions permettant la préservation d’espèces en difficulté.
Replanter certains écosystèmes abîmés, notamment les herbiers sous-marins ou les massifs coralliens, permet de recréer des habitats fonctionnels. L’observation satellitaire, complétée par des réglementations communes, reste utile pour répondre aux risques croissants de pollution ou de pêche illégale, deux éléments perturbant déjà certains équilibres biologiques.
Elle propose un outil de régulation utile, mais l’inconstance régionale dans son application limite son impact. Un effort collectif pour améliorer l’efficacité des contrôles est souhaitable.
Les espèces locales issues de pratiques responsables sont à privilégier, comme le maquereau ou le lieu. Celles pour lesquelles la population est fortement réduite, comme l’anguille, sont à éviter.
Elles représentent une composante importante, mais d’autres actions sont aussi nécessaires : encadrement des pêches, diminution des pollutions, soins aux habitats dégradés et sensibilisation des usagers de produits marins.
Soutenir la vie marine, incluant les tortues, dauphins, dugongs, hippocampes, anguilles ou massifs coralliens, revient à maintenir une part de l’équilibre général des écosystèmes aquatiques. Certaines espèces jouent un rôle de soutien dans les interactions biologiques. Des zones protégées, des quotas modulables, une pêche modérée, des restaurations ciblées et la participation des communautés locales peuvent favoriser ce maintien. Les gestes réalisés individuellement et collectivement influencent directement l’avenir des milieux aquatiques.
Sources de l’article :
- https://biodiversite.gouv.fr/mesure-13-accompagner-le-secteur-de-la-peche
- https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/traite-proteger-haute-mer-biodiversite-marine
- https://biodiversite.gouv.fr/les-ecosystemes-marins-et-cotiers